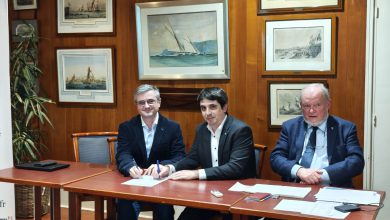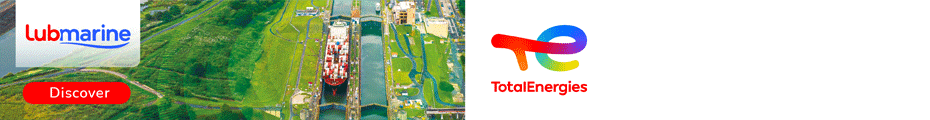Rédiger la critique constructive d’un document soumis à la consultation du public est un exercice délicat qui maintient ses auteurs en équilibre sur une ligne de crête avec, à tribord le risque d’une molle approbation et, à bâbord le danger d’une contestation radicale. Étant donné l’importance que Jeune Marine attache à l’avenir de la profession et à celui de l’ENSM, nous n’avons pas voulu nous dérober. Le document publié a eu le mérite d’ouvrir un débat au sein de la rédaction et avec nos lecteurs, débat que nous avons souhaité résumer par cet article.
Nous interroger sur des propositions formulées dans un style très actuel et proposer des idées de bon sens, enduites de pragmatisme, pourra nous faire passer à nouveau pour des lourdauds confis dans un indécrottable conservatisme maritime. Le conservatisme est pourtant une sage vertu car il consiste à préserver ce qui a été bâti sur l’histoire, l’expérience et les succès sans pour autant refuser d’évoluer face aux changements technologiques et sociétaux.
Nous nous sommes tout d’abord posés deux questions de principe :
« Pourquoi soumettre ces idées à la consultation du public
et pourquoi se projeter en 2040 ? »
Quatre groupes sont concernés par la construction de l’avenir professionnel, car la formation parle d’avenir : les armateurs au premier chef (employeurs), les officiers qui naviguent ou qui ont navigué (l’expérience), les élèves (leurs attentes) et l’État représenté par les Affaires Maritimes et la Direction de l’Enseignement maritime (la stratégie nationale). Si nous comprenons que ces quatre familles ont pu être consultées pour élaborer le catalogue présenté, nous ne sommes pas convaincus que le grand public soit intéressé et compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des propositions. Le simple fait d’utiliser des acronymes et des termes professionnels invalide cette ouverture qui se paie par ailleurs par un résumé aux termes trop généraux. Consulter est une excellente idée, mais la consultation gagne en temps, en efficacité et en lisibilité quand elle s’adresse aux sachants qui ont gagné leur légitimité par l’étude, l’expérience et l’exercice des responsabilités.
Quinze années nous séparent de 2040. Lesquels d’entre les décideurs et prescripteurs actuels seront encore aux affaires en 2040, compte-tenu de la volatilité des carrières et de l’âge des responsables actuels, pour assumer les conséquences du cap donné par le document ? Mais surtout, qui se souviendra en 2040 qu’un tel document avait été rédigé, quand cette longue période aura traversé les tempêtes économiques, les bourrasques politiques et les typhons technologiques ? Bien des exemples dans l’industrie ont montré que cinq années représentent un horizon encore réaliste mais déjà ambitieux. La consigne donnée en 2023 par le gouvernement de doubler les effectifs de l’école à court terme démontre, s’il en était besoin, l’exigence d’une mobilisation immédiate.
Ces préliminaires ayant été posés, nous reconnaissons toute la valeur d’un document d’orientation qui peut se poser comme un engagement mutuel des acteurs concernés à travailler dans une direction convenue et argumentée, et nous pouvons aborder les propositions. Contrairement à ce que prétend Audiard, le marin n’éprouve pas tant le besoin de faire des phrases. Or, certaines formulations, sans doute pour être résumées et conformes aux exigences sociales actuelles, en deviennent opaques : « prendre conscience de la théorie et de la pratique tout au long de la formation mais changer la manière de dispenser la théorie » ne nous éclaire ni sur l’enjeu ni sur la méthode. « Se mettre en quête d’un intérêt renforcé des élèves pour l’ensemble des sujets… » exprime une préoccupation dont la réponse qui a trait à la motivation, devrait découler des mesures concrètes qui seront prises. « Former les bords à la formation » laissera dubitatifs tous ceux qui ont su transmettre leur expérience aux plus jeunes, une pratique sociale respectée depuis toujours à bord, même si celle-ci a pu paraître parfois un peu rugueuse.

Jeune Marine n’a pas la prétention de discuter le bien-fondé de chacune des propositions d’Hydro 2040, ce qui donnerait lieu à un papier trop long pour les lecteurs, mais nous pouvons cependant émettre à notre tour quelques idées de bon sens dont chacun pourra constater si elles se retrouvent dans le document initial ou si elles en sont absentes :
-
L’ENSM a pour vocation première et prioritaire de former des navigants. Le rôle stratégique de la flotte de commerce a encore été rappelé en 2025. La formation des officiers est une mission essentielle. Proposer des formations para-maritimes, toujours intéressantes, ouvre en grand une porte aux élèves que les embarquements rebutent ou que leur curiosité légitime entraîne vers des métiers connexes. La reconversion des officiers ne doit pas se préparer dès l’école : elle sera le résultat futur de l’expérience et de l’excellence de la profession, comme c’est le cas depuis des décennies, décennies qui ont vu des Hydros occuper des responsabilités importantes dans des secteurs très variés. Si certaines spécialités, telles l’expertise, la gestion d’armement, etc… peuvent être proposées au titre de la formation continue (donc ultérieure), elles ne devraient être accessibles qu’après une durée définie de navigation, laquelle rendrait à la nation le service dû après études et apporterait au candidat l’expérience nécessaire pour les aborder.
-
La valeur ajoutée de la polyvalence et l’adaptation de la monovalence à certaines personnes étant aujourd’hui confirmées par l’expérience et le succès de ces filières sur le marché, Hydro 2040 a raison de les classer dans les bagages à conserver.
-
Le mode de recrutement actuel semble poser le problème de la motivation de certains candidats à exercer, ne serait-ce que quelques années, un métier embarqué. La volonté d’exercer le métier pour lequel les cours sont dispensés peut être vérifiée par un concours spécifique (qui ne semble pas incompatible avec Parcours-Sup), par des entretiens approfondis ou en exigeant du candidat un embarquement d’élève de plusieurs mois avant de valider son inscription à l’école, une solution pratiquée dans certains pays étrangers. Rappelons les embarquements de pilotin qui ont tant fait pour susciter l’enthousiasme chez les générations passées et qu’une règlementation abusivement protectrice a peu à peu supprimés. Il appartient ensuite à la qualité des cours, à l’ambiance des écoles et à leur ouverture vers le monde professionnel maritime, de maintenir l’enthousiasme initial dont la plupart des élèves font preuve à leur arrivée. Enfin, si l’obtention d’un diplôme d’ingénieur a une valeur ajoutée, ne serait-ce qu’en termes de reconnaissance du niveau des études, cet intérêt pour les étudiants ne doit pas prendre le pas dans la communication sur la vocation première du brevet.
-
Les quelques réactions à la publication du rapport sur Linkedin ont montré l’attachement des officiers français à la formation continue prise ici dans le sens des filières d’accession aux brevets supérieurs, une longue tradition dans la marine marchande que l’ENSM doit perpétuer en ouvrant plus de passerelles à partir de la reconnaissance des acquis. Une réflexion devrait être engagée sur l’édifice des diplômes et des brevets afin de fluidifier les passages d’un niveau à l’autre (cf article « Devenir officier de marine marchande en Allemagne »). Le mélange des générations à l’école qu’entraîne l’entrée à l’école d’officiers plus âgés en quête d’évolutions est un avantage indéniable pour la maturité générale des promotions. A contrario, il ne semble pas réaliste d’intégrer des personnes venues d’autres métiers et se découvrant une vocation tardive, car les modalités de retraite de l’ENIM comme les limites d’âge et les exigences de santé pourraient compliquer leur gestion de carrière.
-
Les technologies sont en pleine évolution, qui permettent en particulier un positionnement précis d’un navire, un tracé de sa route, des performances optimisées ou des diagnostics de manière automatique et instantanée. Cependant, ne nous y trompons pas : les aides à la navigation ont un niveau de fragilité qui augmente avec leur sophistication. L’échouage du MSC Antonia en mer Rouge (10.05.2025) suite à un décalage sans doute voulu des données GPS, doit nous alerter sur le degré de confiance excessif qu’une génération d’officiers prête au positionnement satellite. L’enseignement des fondamentaux, en navigation comme en mécanique, en électricité ou en météorologie, doit précéder puis accompagner l’apprentissage prudent des technologies avancées. Il doit former l’esprit critique des futurs commandants qui recevront des consignes générées par des centres opérationnels à terre dont les communications restent vulnérables. Dans les fondamentaux, nous plaçons aussi la culture générale qui participe à la formation intellectuelle des futurs officiers en leur donnant des références historiques et littéraires, et leur permet de s’exprimer par oral comme par écrit avec le sens des nuances et de la précision.
-
L’évolution technologique des navires et l’évolution d’usage de la flotte doivent en effet être accompagnées par l’enseignement, d’autant plus quand elles sont encadrées par des textes prescriptifs. Pour éviter de mal étreindre en voulant trop embrasser, il faut d’abord tenir compte du cahier des charges des armateurs qui développent les navires de demain et ont une claire idée des technologies qui vont requérir des officiers spécialisés. Si la navigation vélique soulève un enthousiasme évident, il est certain qu’elle n’emploiera demain qu’un nombre limité d’officiers. L’idée exprimée dans Hydro 2040 de construire des parcours différenciés pourrait répondre à la large palette des spécialités. Un semestre de spécialisation sur l’énergie nucléaire peut être dispensé aujourd’hui pour quelques élèves, mais sans que nous ne sachions encore quand les premiers navires ainsi propulsés navigueront ni combien d’officiers devraient acquérir ces compétences expertes.
-
Les modules de formation exigés en sus de l’enseignement que dispense l’école pour qu’un officier soit opérationnel sur un pétrolier, sur un méthanier, ou sur d’autres navires spécialisés, semblent augmenter avec la règlementation et les recommandations internationales. Quel rôle doit jouer l’école dans leur diffusion ? Là aussi, la question de la spécialité en dernière année se pose comme dans de nombreuses écoles d’ingénieurs.
« En bateau, on sait ou on ne sait pas. Malheur aux tricheurs »
-
« Former au management au sens général » est une proposition ambiguë car le concept moderne du management a déjà un sens trop général. On écrit dans les revues et on enseigne dans les écoles françaises bien des niaiseries pseudo-humanistes sur un management qui serait un art de guider ses collaborateurs sans contrainte ni exigences clairement exprimées. Il ne s’agit pas de cela à bord d’un navire dont le sort et celui de son équipage dépendent de consignes clairement et fermement données, de décisions rapides et assumées, d’une solidarité de destin malgré des écarts culturels entre nationalités, d’un respect mutuel des personnes dans leurs positions respectives. L’encadrement à bord est d’abord fondé sur la légitimité qu’apportent les compétences et l’expérience. Eric Tabarly a écrit « En bateau, on sait ou on ne sait pas. Malheur aux tricheurs ». Cet adage s’applique à la vie à bord des navires de commerce car il n’y a pas de recours extérieur face à l’ignorance. La communauté de vie sur un bateau rend les relations humaines et hiérarchiques particulières. Dans ce domaine, il n’est pas sûr qu’il existe une théorie, et les embarquements doivent permettre d’acquérir le caractère, le comportement et les réflexes que les futures responsabilités exigent.
-
La pédagogie moderne cherche sa voie, entre modes conjoncturelles et économies de moyens. Si nous sommes convaincus par la valeur ajoutée des mémoires concluant des travaux personnels de recherche et de réflexions, travaux qui apportent leur contribution à la collectivité tout en complétant la formation personnelle, nous ne croyons pas un instant aux outils d’enseignement à distance ou d’autoévaluation qui cherchent trop souvent à compenser des manques de ressources enseignantes.
Nous n’avons résumé ci-dessus qu’un nombre très limité d’idées, plutôt à titre d’exemples. Reprendre plus en détails le catalogue d’Hydro 2040 présente plusieurs difficultés : le nombre d’items et leur variété, d’abord, mais aussi l’imprécision qu’apporte la formule du résumé. Comment contester le besoin de « favoriser le travail d’équipe », ou de « faire la pratique rapidement après la théorie » ? Mais comment déduire de ces affirmations la manière dont l’école songe à les mettre en pratique ?
Si l’exercice de se projeter dans les années à venir est utile et constructif, le document mis en ligne manque malheureusement de précision et de priorisation et la période estivale n’était sans doute pas la plus propice à un débat ouvert…
Si toutes les propositions d’Hydro 2040 ne recueillent pas l’assentiment des lecteurs de notre magazine, certaines méritent d’être prises en considération. Nous avons conscience que l’exercice de projection fait par l’ENSM est un exercice délicat, et notre contribution se veut constructive. Le texte qu’un élève nous a fait parvenir remet la formation et les préoccupations quotidiennes des principaux intéressés au cœur du débat. Nous publions sa contribution dans son intégralité car elle reflète la majorité des idées partagées :
« En tant qu’élève, je trouve positif que l’ENSM cherche à se projeter avec Hydro 2040. Cependant, ce regard vers l’avenir ne doit pas faire oublier les besoins immédiats et le vécu concret des étudiants. C’est peut-être en partant du terrain que le projet gagnerait en crédibilité.
Sur le « management », l’idée est juste mais le traitement actuel ne convainc pas. Passer des heures sur l’ERM et le BRM, c’est utile en théorie, mais vite limité quand on ne parle que de généralités ou de notions sans lien direct avec le quotidien. Le vrai apprentissage du commandement, c’est l’expérience embarquée, la responsabilité en situation réelle, pas des heures de diapos. La mise en pratique reste, selon moi, le moyen le plus efficace pour progresser. Elle peut se faire à bord, mais aussi lors de travaux pratiques : séances de simulateur, exercices collectifs, TP… à condition d’y intégrer cette dimension managériale aux exercices.
L’idée de cours optionnels paraît séduisante mais peu réaliste. L’administration a déjà du mal à assurer certains enseignements. Et si ces options remplaçaient des bases comme la cartographie, l’astronomie ou la météo, ce serait un recul grave. Les fondamentaux ne sont pas du passé : ils donnent aux futurs officiers le recul et l’esprit critique nécessaires pour utiliser les outils modernes.
Même interrogation sur la volonté d’ouvrir les cursus sur tous les sites : quel intérêt concret ? Si déjà on manque de professeurs dans certains sites, comment en trouver pour multiplier les doublons partout ? L’idée ressemble plus à un caprice qu’à un vrai projet utile. En effet, cela n’apporte pas de véritable plus-value néanmoins a un coût qui est bien réel.
Enfin, un mot sur le management de l’école elle-même : attention à ne pas trop « encadrer » les élèves. L’ENSM n’est pas là pour protéger, mais pour préparer à un monde maritime compétitif, parfois brutal, où les armateurs et les pressions commerciales sont très présents. Former des officiers, ce n’est pas fabriquer des diplômés fragiles, mais des marins capables d’affronter la réalité du métier. Cela ne veut pas dire accepter les abus qui existent parfois à bord, ni brutaliser les élèves. Mais il faut rappeler qu’il s’agit d’une école supérieure, pas d’un collège.
Bâtir l’école de 2040 est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier les problèmes simples et actuels : un espace de restauration trop petit par rapport au nombre d’élèves, des salles de cours parfois si exiguës qu’on ne peut même pas y circuler… Prendre ces réalités en compte renforcerait la crédibilité du projet global.«
Propos recueillis et compilés par Eric BLANC pour la rédaction de Jeune Marine