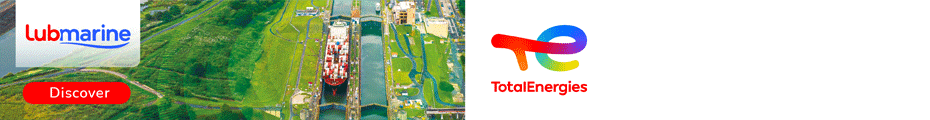Alors que les pressions environnementales, économiques et géopolitiques redessinent les contours du commerce maritime, je me posai cette question : et si la marine marchande réintégrait le nucléaire civil comme solution de propulsion ? Plus précisément, que se passerait-il si un porte-conteneurs moderne était conçu, dès l’origine, pour embarquer une chaufferie nucléaire ? Non pas pour une propulsion mécanique directe, comme sur les sous-marins nucléaires, mais pour produire de l’électricité alimentant toute la chaîne énergétique du bord : propulseurs électriques, auxiliaires, confort de l’équipage.
Cet article est une expérience mentale. Il s’agit d’un exercice d’ingénierie, d’architecture navale et de stratégie industrielle : imaginer un navire qui pourrait sortir aujourd’hui, dans un chantier comme celui de Saint-Nazaire. Un porte-conteneurs nucléaire, pensé autour de sa centrale embarquée. Quels choix technologiques ? Quelles contraintes structurantes ? Quelles lignes commerciales ? Et surtout, quels marins pour le faire fonctionner ?
La chaufferie : cœur énergétique du navire
Comme on conçoit un roulier autour de ses ponts garages, il faut ici tout doit être pensé autour de son système de production électrique et de sa chaufferie. Le choix du réacteur est donc fondamental. Dans un précédent article (« Les réacteurs nucléaires pour la marine marchande »), nous avions identifié les réacteurs à sels fondus (RSF) comme prometteurs, mais encore trop immatures. Leur filière de traitement des déchets est inexistante, tout comme leur retour d’expérience en milieu marin. Pour un navire à construire aujourd’hui, mieux vaut se tourner vers une technologie éprouvée. Les petits réacteurs modulaires à eau pressurisée (SMR de type REP) s’imposent donc. Leur conception est bien connue, les systèmes de sûreté passive sont intégrés, et l’infrastructure de retraitement du combustible déjà existant, si l’on imagine utiliser le même combustible que les REP terrestres. Le problème du démantèlement reste entier, la France ne disposant pas encore d’une filière industrielle dédiée, mais cette limite est valable pour tous les navires à propulsion nucléaire.
Concrètement, on pourrait imaginer une installation composée de deux modules de 150 à 200 MW thermiques chacun. Cette puissance paraît imaginable quand on sait que le nouveau porte-avions américain, l’USS Gerald R. Ford, possède deux chaufferies qui peuvent produire chacune d’entre elles 300 MW. Les chaufferies nucléaires fourniraient de la vapeur pour des turbines à vapeur de haute efficacité couplées à des alternateurs. L’électricité produite alimente toute la chaîne énergétique du navire : propulsion, auxiliaires, équipements portuaires, confort à bord.

Une architecture au service de la puissance
Avec une telle puissance disponible et un coût de construction élevé, le navire doit atteindre une taille similaire voire plus importante que ses homologues thermiques pour être économiquement viable. On s’oriente donc vers les dimensions d’un Megamax-24 : 400 mètres de long, 61 mètres de large, 23 000 EVP minimum. Mais un tel navire gagne aussi en volume utile. Sans cuves à fuel ni systèmes de traitement des gaz d’échappement, l’espace libéré peut être réaffecté à la cargaison. On peut donc viser une capacité supérieure à celle des navires actuels fonctionnant au gaz ou au fuel — soit une capacité de plus de 23 000 EVP.
Prenons comme référence le Jacques Saadé, navire amiral de CMA CGM, propulsé au GNL, et imaginons-le en porte-conteneurs nouvelle génération, propulsé par l’atome. Long de 400 mètres, large de 61 mètres, il affiche une capacité d’emport d’environ 23 000 EVP. C’est un Megamax-24, soit le format maximal pour franchir le canal de Suez à pleine charge. Notre porte-conteneurs nucléaire reprendrait ces dimensions, mais avec plusieurs gains structurels.
Premièrement, l’absence de cuves à gaz ou à fuel libère un volume considérable. Sur le Jacques Saadé, les réservoirs de GNL représentent plus de 18.000 m³ de volume embarqué. Dans notre cas, la chaufferie nucléaire, bien que volumineuse et cloisonnée dans une « citadelle » de sûreté, occupe un volume concentré sous le château.
Deuxièmement, l’absence de systèmes d’échappement (cheminées, scrubbers, traitement des gaz) libère la zone supérieure avant dédiée aux échappements et simplifie la structure. Seules des aérations de sécurité sont nécessaires, ce qui permet de dégager de l’espace pour des containers ou pour des équipements auxiliaires.
Troisièmement, la densité énergétique du combustible nucléaire est sans commune mesure avec celle du gaz ou du fuel : on parle de quelques dizaines de kilos par an contre des milliers de tonnes. Cela permet de repenser totalement les réserves, les autonomies et l’organisation des ponts inférieurs.
Ainsi, on peut envisager une capacité légèrement supérieure à celle du Jacques Saadé, sans modifier la taille du navire. Le porte-conteneurs nucléaire pourrait dépasser les 23 000 EVP tout en conservant les contraintes dimensionnelles imposées par les grandes infrastructures maritimes telles que le canal de Suez.
Enfin, la citadelle nucléaire, compartimentée et isolée sous le château, ne vient pas perturber l’équilibre du navire : son centre de gravité reste bas, la stabilité est conservée, et l’intégration dans la chaîne industrielle de maintenance est facilitée.
Une vitesse supérieure, un temps gagné
Au-delà de sa capacité d’emport, la centrale nucléaire offre un autre atout stratégique : la vitesse. Outre l’avantage environnemental, ce navire gagne aussi en performance. La puissance thermique disponible, dépassant celle des moteurs deux-temps classiques, permettrait une vitesse de croisière supérieure. Prenons comme base le Jacques Saadé (propulsion GNL, 16–17 nœuds de vitesse moyenne). Pour une ligne Europe-Asie, soit environ 11 000 milles nautiques, il faut 25 à 28 jours de traversée. Si le porte-conteneurs nucléaire maintient une moyenne de 20 nœuds, on pourrait tomber à 22–23 jours. Soit un gain de 4 à 5 jours par rotation, très significatif sur une ligne régulière. Il représente près de 20 % de gain sur le temps de traversée.
Un équipage renforcé
Toute exploitation d’un réacteur, même embarqué, doit répondre à des standards de sûreté stricts. Il faudra donc s’assurer que l’équipage dispose non seulement des compétences techniques classiques, mais aussi des habilitations et protocoles spécifiques au nucléaire civil. Un tel navire nécessiterait un équipage renforcé, à l’image des méthaniers ou des porte-conteneurs GNL, qui embarquent déjà du personnel formé à l’exploitation de cette énergie. En plus des marins traditionnels (machine, pont), il faudrait embarquer des techniciens nucléaires, avec probablement au moins trois ingénieurs spécialisés à plein temps, intégrés à l’équipage de quart. Finalement, un quart sur un porte-conteneurs nucléaire pourrait être composé, par exemple, d’un officier chef de quart, formé à la gestion nucléaire et aux risques associés, assisté de plusieurs techniciens spécialisés : un pour la surveillance de la chaufferie nucléaire, un autre pour la partie mécanique classique de la salle des machines et pour superviser les systèmes auxiliaires.
Ce besoin en compétences spécifiques pose la question de la formation initiale et continue. Faudra-t-il créer une filière “officier machine nucléaire” au sein des écoles de la marine marchande, ou bien cette spécialisation se fera-t-elle comme pour la propulsion vélique ou la formation glace avancée : sous forme de stage à part, à la charge de l’armateur ou du marin ? Pourrait-on imaginer une formation commune avec la Marine nationale, ou du moins partager certains modules techniques ? Quels partenariats seraient nécessaires avec des acteurs comme l’Autorité de sûreté nucléaire, TechnicAtome ou Naval Group ? Comment garantir le renouvellement des compétences sur le long terme ?
Sur quelles lignes opérer ce navire ?
Ce porte-conteneurs nucléaire est pensé pour la haute mer. Il doit opérer sur de longues lignes régulières, entre ports capables d’accueillir un navire de très grande taille et surtout disposés à accepter un bâtiment à propulsion nucléaire. Des lignes comme Asie-Europe, Asie-Amérique du Nord ou Europe-Amérique du Sud s’imposent. Il faudra aussi que les États concernés adaptent leur réglementation portuaire et leur acceptation politique. À court terme, un armateur chercherait probablement à exploiter ce type de navire sur une route maîtrisée : entre deux ou trois hubs logistiques majeurs où il dispose déjà d’une forte présence, d’une infrastructure à terre bien établie et d’une influence politique suffisante pour faciliter l’acceptabilité réglementaire.
Prenons l’exemple de CMA CGM. Le groupe contrôle déjà des terminaux stratégiques à Marseille-Fos, au port du Havre, à Singapour ou encore à Ningbo-Zhoushan en Chine. Une ligne Europe-Asie entre Fos-sur-Mer et Ningbo, avec une escale à Singapour, constituerait un axe pertinent pour l’exploitation initiale d’un porte-conteneurs nucléaire. Ces ports sont capables d’accueillir des géants de type Megamax, disposent de capacités de remorquage adaptées, de bassins de maintenance, et, surtout, font partie d’un réseau logistique intégré que CMA CGM maîtrise déjà. Ce choix permettrait de concentrer les efforts réglementaires, d’organiser une surveillance renforcée des opérations et de capitaliser sur un réseau interne de confiance, avant d’envisager une généralisation de ce type de propulsion à d’autres lignes commerciales.
Conclusion : une projection crédible ?
Ce porte-conteneurs nucléaire, fruit de mon expérience mentale, pourrait être réaliste dès aujourd’hui, au moins sur le plan technique. Les technologies existent. Les chantiers sont capables de le construire. Les systèmes de sûreté sont éprouvés. Reste à faire évoluer le cadre réglementaire, la chaîne logistique et mobiliser les financements nécessaires. Un tel navire représenterait une rupture stratégique dans le transport maritime : fin de la dépendance aux combustibles fossiles, réduction drastique des émissions, gains de performance, mais aussi bouleversement des compétences requises et des modèles économiques.
Ce ne serait pas un simple navire, mais bien une nouvelle génération de flotte. Et peut-être, un nouveau chapitre de la marine marchande, et d’une certaine manière, un retour à la vapeur, mais version XXIe siècle, propre, silencieuse, décarbonée.