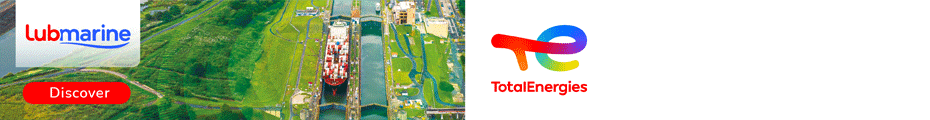La 15eme édition des Assises Port du Futur a réuni au sein de l’ENSM du Havre les principaux acteurs du paysage portuaire français. Organisées par le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; agence regroupant l’État et les collectivités territoriales). Les différentes tables rondes ont abordé un large panel des problématiques portuaires dans un environnement de plus en plus imprévisible et chaotique : géostratégique, économique, juridique, climatique etc.
Dans son discours d’accueil, Benoît ROCHET, DG d’HAROPA PORT co-organisateur de ces assises a énuméré les principaux défis des ports : diversifier, maîtriser le foncier, sécuriser, connecter, décarboner, intégrer à l’environnement en anticipant le changement climatique, employeurs exemplaires et ambitieux dans leurs investissements.

Petite touche d’ouverture à l’international, l’ambassadrice du Danemark, Son Excellence Madame Hanne FUGL ESKJAER a présenté le partenariat stratégique entre la France et le Danemark, notamment les aspects portuaires et énergétiques. Frederik THURE, attaché à l’ambassade du Danemark, a présenté la transformation rapide du port d’Esbjerg. Premier port de pêche danois à la fin du XXe siècle, il est devenu le premier port éolien avec l’ambition d’être le premier port européen pour la production des nouvelles molécules énergétiques.
« Garantir la souveraineté dans un monde fracturé »
La première table ronde a permis de dresser un état de la situation des trafics portuaires au travers de quelques focus.
La souveraineté est l’autonomie dans la liberté de choix de la part d’un peuple souverain. Les ports sont importants dans la résilience face aux menaces hybrides, comme les drones, mais également comme moyen de report en cas de neutralisation opérationnelle. Ce report vers un autre port est simple en Europe, mais impossible dans nos Outre-mer qui sont ultra dépendants de la mer pour leurs approvisionnements.
L’exemple du marché des céréales illustre bien les difficultés pour les ports de s’adapter aux aléas. Le marché actuel des céréales est déséquilibré avec une montée de la production agricole autour de la mer Noire, en Russie et des récoltes erratiques qui entraînent une volatilité des cours mondiaux. La France est devenue une variable d’ajustement sur ce marché imprévisible en fonction de la disponibilité des navires. Depuis 2020, le marché algérien s’est progressivement fermé aux blés français, qui doivent se rabattre sur le Maroc, la Tunisie et surtout l’Égypte. Alors que la consommation annuelle de céréales et d’oléagineux stagne au niveau mondial, la production bat des records. Cela entraîne une concentration dans les ports, car il y a une surcapacité logistique en France.
Pour le gaz, le marché est en surcapacité en raison d’une baisse de la consommation.
Pour les gestionnaires des cinq terminaux métropolitains, l’enjeu est de transformer les installations actuelles en « hubs multi-molécules » pour répondre aux défis de la décarbonation. Elengy a plusieurs projets de captures du CO2, de transformation d’un oléoduc en gazoduc pour du CO2 liquéfié à l’export, soutage de nouveaux produits etc. Cela nécessite des actifs lourds et longs à mettre en place.
Pour les chargeurs, les trois points importants sont la création de « corridors verts », la digitalisation complète de la chaîne logistique, et le coût de passage portuaire tolérable. Les compagnies maritimes investissent fortement dans toute la chaîne logistique, en rachetant notamment des terminaux portuaires, qui ont une importance stratégique. La surcapacité augmentant, les taux de fret devraient chuter.
40% du fret français passe par des ports étrangers. L’objectif des chargeurs est de récupérer 20% à Anvers. Anvers bénéficie d’un écosystème local adapté, en particulier d’entrepôts logistiques performants. Les problèmes de la France sont la desserte ferroviaire et le climat social. Bref, rien de nouveau depuis cinquante ans. Il en va de la compétitivité de nos exportateurs.
Les intervenants de cette table ronde considèrent qu’il faut changer la méthode pour mesurer la performance d’un port. Abandonner l’indice de la tonne manutentionnée pour une indication de la valeur commerciale des trafics portuaires : bonne idée ? Ou vouloir changer de thermomètre quand on n’accepte pas le réel, en voulant d’un coup de baguette magique résoudre la problématique.
« Imaginer les infrastructures de transport à l’horizon 2040 »
Les participants à la seconde table ronde se sont livrés à un exercice de prospective sur le transport multimodal en 2040, en parlant surtout de la situation actuelle. Le report modal est fonction de la densité industrielle d’une zone et de la profondeur de l’hinterland desservi par des corridors.
Pour le ferroviaire, les pistes de progression sont la disponibilité et les performances des sillons, l’adaptation des infrastructures et l’interface du réseau national avec celui des ports.
Pour le fluvial, l’héritage du passé pèse fortement, avec une concentration géographique au Nord-Est d’un réseau de 6700 km, comportant seulement 2200 km au grand gabarit. Une remise à niveau nécessiterait au minimum 500 millions d’euros par an.

Les vraies perspectives viendront du privé, à l’image de la société Modalis, groupe familial spécialisé dans le transport combiné et le report modal. Pour Patrick BOURREAU, Directeur de la stratégie de Modal Groupe, la clé du succès est une vision commune de tous les acteurs permettant une bonne gouvernance.
Pour illustrer son propos, il a comparé deux projets semblables en France. Le projet Tonkin sur Marseille a été abandonné après quatre années d’efforts, des centaines de réunions, 600.000 euros de frais, sans réussir à obtenir un consensus.
A Dunkerque, un appel à manifestation d’intérêt lancé en juillet 2024 a entraîné une décision en mai 2025, lançant un investissement de 25 millions d’euros pour être opérationnel en avril 2026. Dans le Nord, toutes les parties prenantes ont joué le jeu sans complication.
« Corridor numérique, un accélérateur d’efficacité portuaire »
Les spécialistes du numérique ont dressé un état des lieux et présenté le futur immédiat permis par les avancées technologiques, notamment l’apport de l’IA.
La nouvelle phase de développement numérique est de créer des corridors numériques des quais jusqu’au destinataire final. Ce numérique prédictif doit associer l’IA, le calcul et les jumeaux numériques. Le but est de mieux prévoir et d’anticiper les incertitudes …. Jusqu’aux grèves ??? pas sûr !!!
Les réseaux privés en 5G ne sont pas assez développés en France, en raison d’un souci de continuité de flux entre les réseaux privés et le réseau public.
Le numérique va automatiser les terminaux et révolutionner la façon de travailler des personnels dockers. L’exemple du jumeau numérique de la GMP, présenté aux trophées de l’innovation en est l’exemple type : il permet de responsabiliser chaque intervenant en temps réel… mais aussi d’ouvrir indirectement une vision globale du terminal aux …narcotrafiquants !!!
« Le foncier : un atout au service de la stratégie des territoires portuaires ? »
Les ports sont devenus des gestionnaires de foncier, sorte de SAFER des espaces de zones industrielles à l’arrière des quais. Derrière les arguments de la transition écologique, de la réindustrialisation « verte » et des corridors logistiques, les ports tentent de valoriser leurs domaines fonciers pour ménager l’avenir. L’exercice est difficile, car il faut répondre aux attentes des clients potentiels dans un univers juridique de plus en plus contraint qui ne laisse aux ports français que 2000 hectares de potentiel foncier. Quand les ports sont enclavés dans une ville, la solution est une extension vers la mer. Derrière ce « Monopoly » portuaire se joue la principale ressource financière des ports.
« Les services aux navires, un maillon essentiel de la performance des ports et corridors »
Les services aux navires regroupent tous les intervenants « stratégiques » incontournables au passage portuaire d’un navire. Qu’ils soient agent maritime, représentant du remorquage, du lamanage, du pilotage ou gestionnaire de ports, leurs prestations de service sont les bases de l’efficacité et du coût de l’escale. Chacun a développé les actions entreprises pour diminuer l’impact carbone des activités de service aux navires.
Pour les ports secondaires, la difficulté est de pouvoir proposer l’ensemble des services aux navires, notamment le remorquage en raison d’un trafic insuffisant pour déléguer ce service au privé. La mise en application des nouvelles réglementations à l’horizon 2030 pour l’électrification des quais se heurte à un mur d’investissements et de rentabilité, sachant qu’une prise pour un paquebot c’est 12 millions d’euros et pour un ferry entre 5 et 6 millions d’euros.

« Ports sous surveillance : sûreté, cybersécurité et intégrité à l’épreuve des risques »
La dernière table ronde a abordé les thèmes récurrents du trafic de stupéfiants, de la corruption et des cyberattaques. L’ampleur des trafics illicites dans les ports est exponentielle : narcotrafic, traite humaine, biens volés ou contrefaits, marchandises sous embargo, déchets, espèces animales ou végétales.
D’après une étude de l’ONU, le marché du narcotrafic est égal au PIB espagnol, soit environ 500 milliards de dollars. L’IA et les algorithmes doivent apporter plus d’efficience dans la détection des trafics de drogues. Mais paradoxalement, la numérisation des ports ouvre des portes aux narcotrafiquants…en facilitant le contrôle de leurs propres chaînes logistiques.
Côté juridique, la loi du 13 juin 2025 sur les narcotrafics est inapplicable, notamment dans les ports de plaisance qui n’ont pas de pouvoir de police. Nul n’est à l’abri de tentatives de corruption difficilement détectables si la gouvernance est défaillante.
Les moyens numériques des ports sont maintenant bien sensibilisés aux risques de cyberattaques. Ces dernières sont de trois types :
– Massives à but lucratif, facilement détectables. 10 000 attaques de ce type annuellement au port de Marseille.
– Personnalisées sur des agents portuaires, pour une escroquerie financière. Une centaine par an au port de Marseille, qui sont chronophages pour les services informatiques.
– Étatiques ou terroristes contre un port, dans le but de suspendre les opérations portuaires. Elles sont discrètes et capables de faire des dégâts. Cela demande un travail de remise en service des systèmes et de savoir s’organiser quand il n’y a plus d’informatique en participant aux exercices de l’ANSI.
A noter pour l’ensemble des acteurs maritimes le M-Center de France Cyber Maritime basé à Brest pour répondre aux attaques cyber et apporter une assistance d’experts.
Les 9èmes trophées de l’innovation ont ensuite récompensé quatre projets :
-

©JVD Jeune Marine Geocorail, qui utilise les déchets des coquilles pour recréer par électrolyse des blocs de renfort immergés.
- Bordeaux technopole, incubateur de start-up du port de Bordeaux.
- La GMP pour la création d’un jumeau numérique du terminal de France au Havre, permettant de suivre en temps réel l’ensemble des opérations du terminal, et ainsi améliorer sa productivité. Ce projet a eu aussi le prix du public.
- Le Moulin de marée qui imagine utiliser l’énergie des marées dans les ports, pour alimenter en électricité des installations type entrepôts frigorifiques.