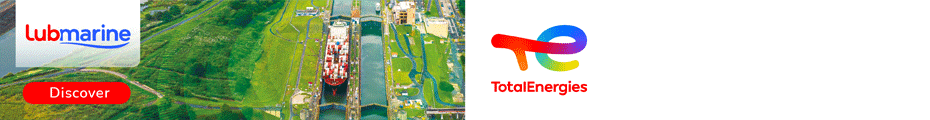Dans les préliminaires de son rapport, le député Yannick CHENEVARD cite la guerre des Malouines comme un exemple récent de projection de moyens militaires par des navires de commerce, exemple qui a été repris par le vice-amiral SLAARS lors de la conférence du 6 mars organisée par Jeune Marine à l’ENSM du Havre.
Cette guerre avec l’Argentine, qui prit les Britanniques par surprise, est-elle un cas isolé dans l’histoire ? Certes non : sans réécrire l’histoire de nos civilisations qui s’est toujours déclinée en mer, il est possible d’en citer quelques jalons pour confirmer que la flotte stratégique n’est pas une idée neuve et doit être considérée comme une constante dans la stratégie de défense d’un pays.
Le mythe d’une époque heureuse pendant laquelle notre pays se serait suffi à lui-même, a la peau dure, laissant croire que nos ressources intérieures furent jadis suffisantes pour se contenter de chars à bœufs puis de locomotives afin d’acheminer la nourriture et les équipements d’une nation en guerre. Notre économie a toujours été ouverte, et cette ouverture a tôt regardé vers l’outre-mer pour quérir les matières que notre sol ne produisait pas, confiant aux navires la tâche de rapatrier ces indispensables richesses. Le revers de cette ouverture s’appelle le blocus : dès qu’une puissance adverse veut affaiblir un pays, elle commence par empêcher l’accès aux ressources extérieures en coupant ses routes maritimes. Dès lors, la préoccupation première de la nation assaillie est de les restaurer en perçant les lignes de navires de guerre que l’ennemi a placées sur les accès aux ports, afin d’approvisionner son industrie de guerre, voire de nourrir sa population. La pratique d’empêcher l’entrée et la sortie des ports ennemis et d’intercepter les navires qui font commerce avec les ports ennemis est aussi ancienne que la guerre maritime.
Sans remonter aux puissances thalassocratiques de l’antiquité que leurs flottes enrichissaient et en se contentant des deux siècles passés, le rôle des flottes de commerce dans les victoires ou dans les défaites est essentiel même s’il est moins connu du grand public et moins salué par les historiens que celui plus illustre joué par les navires de guerre.
L’exemple le plus frappant dans l’histoire française est la relative faiblesse de Napoléon Ier sur mer, un conquérant dont la stratégie fut d’abord terrienne. Le Royaume- Uni, en engageant peu d’hommes à terre mais en investissant les routes maritimes, perturba gravement la logistique de guerre française que la guerre continentale ne compensa jamais. En effet, Albion ordonna dès 1793 la saisie de tous les navires neutres à destination d’un port de France, ce qui revenait à décréter toutes les côtes du pays en état de blocus. Dans ses mémoires, l’amiral George COCKBURN, qui convoya l’empereur déchu vers Sainte-Hélène, évoque les regrets de celui-ci quant aux faiblesses de sa politique maritime dont on peut considérer qu’elle lui fut fatale (Napoléon sur la route de Sainte-Hélène – Éditions Voilier Rouge).
La guerre de sécession apporte un éclairage moderne sur la force d’un blocus et les enjeux liés au commerce maritime. Le Nord mobilisa cinq cents navires pour empêcher tout échange par voie de mer avec les États confédérés, lesquels répondirent en lançant ou affrétant des navires forceurs de blocus dont la mission première était d’exporter le coton, seule ressource du Sud. Malgré une grande habileté et de nombreux succès, mille cinq cents d’entre eux furent détruits et les exportations du Sud chutèrent de 95%, ruinant la Confédération qui ne put financer son effort de guerre.
Si les batailles meurtrières de la Marne restent gravées dans notre mémoire collective, la première guerre mondiale se joua aussi sur mer avec un ballet croisé entre bloqueur et bloqué, chaque belligérant essayant d’affaiblir l’autre en le coupant de ses lignes de ravitaillement. Le meilleur témoignage sur le rôle discret et pourtant essentiel des navires de commerce dans le conflit reste L’Odyssée d’un transport torpillé de Maurice Larrouy (Éditions Perrin). Un témoignage, certes apocryphe mais très étayé, qui met en scène un petit cargo chargé par l’Amirauté de rapporter en France du charbon et du bois (nécessaire dans les tranchées) ou de ravitailler le front oriental. L’Allemagne comprit dès le début du siècle dernier l’importance tactique et psychologique qu’auraient les sous-marins pour envoyer par le fond les navires de commerce ; le début d’un traumatisme pour les marins marchands, ces grands oubliés du conflit.
Depuis 1905, les Anglais avaient adjoint une cinquième branche à la Navy : la Royal Fleet Auxiliary, un nom britannique pour une flotte stratégique puisque celle-ci comprenait des navires civils réquisitionnés. Quand la seconde guerre mondiale éclate, ce pays manufacturier est le plus gros importateur de matières premières au monde, un statut que va vite renforcer le besoin de soutenir l’effort de guerre. Le risque d’asphyxie est grand. Bien avant les États-Unis qui entreront en guerre en 1941, le Canada, membre du Commonwealth, fait passer ses navires marchands sous le contrôle de la Marine Royale et organise les premiers convois. Dès la fin 1939, 410 bateaux répartis dans quatorze convois ont rallié l’Angleterre. Les sous-marins allemands qui chassent en Atlantique coulent jusqu’à vingt pour cent des convois.

Lundi 6 mars 2023, le sous-marin indien type Kilo l’INS Sindhuratna arrive au port du Havre pour y effectuer une escale de trois jours. Le commandant, le capitaine de frégate Ravindra Yadav, accompagné de monsieur l’ambassadeur d’Inde en France Jawed Ashraf, ainsi que le général Zubin Bhatnagar, attaché de Défense indienne en France et l’attaché naval Surender Singh Chauhan, rencontre le capitaine de vaisseau Frédéric Janci, commandant maritime au Havre et monsieur le premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe.
Quand les États-Unis rejoignent les forces alliées, le convoyage prend une nouvelle dimension. Dix-huit nouveaux chantiers navals sont construits qui lanceront 2700 Liberty ships, ces cargos de 15.000 tonnes de port en lourd qui furent baptisés « l’arme la plus efficace » de ce conflit. Sans eux, donc sans les marins qui les armaient, la victoire des Alliés eût été impossible.
Mais le tribut à payer fut aussi lourd qu’ingrat pour les marins, artisans de la victoire jamais reconnus. L’Allemagne disposait en 1942 de 300 sous-marins qui firent des ravages dans les nombreux convois. Mars 1943 fut le mois le plus meurtrier avec 108 bateaux coulés. Officiers et matelots connaissaient le sort qui les attendait, en particulier si leur navire était chargé de matières dangereuses ou trop lent.
Une remarque connexe : le Liberty ship fut délibérément et même pour l’époque un navire très simple car seule comptait la cadence de fabrication. Que seraient nos choix actuels s’il fallait renforcer rapidement une flotte stratégique ? Quel niveau de simplification technique saurait-on atteindre, ou, autrement dit, quel niveau de technicité serait compatible avec une construction locale et rapide ?
Après 1945, les navires de commerce français n’en avaient pas fini avec les conflits : les guerres d’Indochine et d’Algérie exigèrent de leur part un gros soutien logistique. Un article paru dans Jeune Marine en février 1989 sous la plume de J.R. Delorme et exhumé pour mon plus grand plaisir par Jean-Vincent DUJONCQUOY raconte l’évacuation d’Haiphong à laquelle participa le cargo de l’auteur, alors chef mécanicien : outre les voitures, les meubles ou les outils, les valeureux marins français durent prendre en charge les dames d’un pensionnat bien particulier qui « ne souhaitaient pas goûter du Viet » mais qui apprécièrent les Bretons. Effort de guerre et flotte stratégique, vous dis-je !
1982 est encore une année de conflits lointains pour l’Europe : la France doit organiser à l’automne la logistique navale de l’opération Épaulard au Liban en soutien à la FINUL qui tente de séparer les protagonistes de cette guerre, tandis que le Royaume-Uni a dû dès le printemps riposter à l’attaque des Malouines par l’Argentine. Comme évoqué dans l’introduction de l’article, cette guerre et sa logistique sont des cas d’école souvent étudiés. Les Anglais étant conservateurs, le concept de Royal Fleet Auxiliary créé en 1905 existe toujours quand se pose la question de projeter en urgence des troupes et des armes vers les antipodes australs. La cure d’amaigrissement de la Royal Navy a été telle qu’il faut mobiliser en urgence des navires de commerce. C’est ainsi, entre autres, que le Queen Elizabeth 2 va acheminer la 5ème brigade d’infanterie tandis qu’un porte-conteneurs, l’Atlantic Conveyor va être réaménagé en urgence pour transporter vingt-cinq avions.
De nombreux analystes ont établi un parallèle entre ce conflit post-colonial au cours duquel le Royaume-Uni réaffirma sa souveraineté sur des îles lointaines mais stratégiques, et la situation de nos territoires d’outre-mer, tout aussi éloignés et soumis à des opérations de déstabilisation par des puissances étrangères, opérations amenant des troubles comme en Nouvelle-Calédonie pour lesquels la logistique maritime cumule les rôles sécuritaire et humanitaire. Je renvoie à l’excellente synthèse faite par la revue Conflits :https://www.revueconflits.com/la-guerre-des-malouines-succes-et-limites-dune-comparaison-avec-la-situation-francaise/. Même en faisant fi de ces conflits larvés, les catastrophes naturelles qui affectent ces territoires démontrent l’impérieuse nécessité pour une nation qui veut les conserver en son sein, de disposer d’une logistique maritime qu’il serait dommage et inefficace de confondre avec des unités combattantes auxquelles d’autres missions sont confiées.
Lors de la conférence du 6 mars, organisée par Jeune Marine à l’ENSM du Havre, le contre-amiral Pierre RIALLAND, Secrétaire général adjoint de la mer, a fait état des travaux actuels de la Conférence Nationale Maritime dont les membres ont identifié vingt situations de crise qui pourraient nécessiter l’utilisation de navires de commerce. Il est donc urgent de s’y préparer, car tôt ou tard…
Eric BLANC