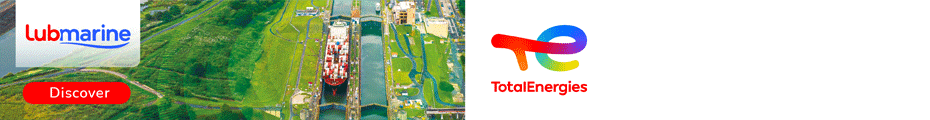Entre révolution technologique et instabilité géopolitique, le monde maritime vit une période transitoire. Nouveaux moteurs, nouvelles routes, nouveaux systèmes de routage… Mais qui dit nouveau, dit aventure ! Et qui dit aventure, dit incertitude : une incertitude qui peut effrayer les investisseurs, tant pour la construction que pour l’exploitation du navire. À l’occasion des Assises de l’Économie de la Mer 2024, une table ronde a réuni banques, avocats au transport et assurances : comment financer un monde maritime instable ?
« La transition [énergétique] est déjà bien amorcée », tempère Philippe Renaudin. Le Directeur de la filière maritime de la Banque Populaire Grand Ouest travaille sur des projets de toutes tailles : aussi bien le financement individuel, de 5 à 100 millions d’euros, que le cofinancement de navires en construction à Saint-Nazaire, dépassant parfois le milliard d’euros. « Cependant, notre modèle économique exige un investissement très lourd, qui comporte aujourd’hui des inconnues. Un navire vit plus de vingt ans, la transition va s’étaler sur plusieurs décennies. Où en sera-t-on dans dix ans ? Vingt ans ? ».
L’enjeu premier est la garantie sur le retour d’investissement. « N’importe quel projet maritime commence avec des actifs : un prêt, avec quelques garanties », explique Christine Ezcutari. En qualité d’avocate en affaires pour le cabinet Norton Rose Fullbright, elle travaille tant sur le financement que sur l’assurance du navire et de sa cargaison. « Mais la transition énergique touche la valeur de chaque navire. Si un navire adopte une propulsion qui disparaît dans cinq ans, que vaut-il sur le marché de l’occasion ? »

Du point de vue des assurances, les nouvelles technologies offrent peu ou pas de recul. « Les assurances utilisent d’abord le retour d’expérience, pour quantifier le risque », analyse Henry Allard, Président opérationnel du cabinet de courtage Filhet Allard Maritime. « Mais avec les nouvelles technologies, on n’a pas encore ces retours d’expérience ». Une situation qui peut effrayer les assureurs : « nous pouvons être amenés à jouer les apprentis sorciers, mais nous devons rester prudents », explique-t-il, mentionnant notamment le développement des batteries au lithium. Henry Allard définit son rôle comme une aide à appréhender les risques, afin de rassurer les assurances et les investisseurs.
Pour financer un projet, Philippe Renaudin définit trois critères fondamentaux : en tête, bien entendu, l’aspect réglementaire, avec une installation certifiée et validée. « Il s’agit ensuite d’une collaboration technique : l’armateur et le motoriste travaillent ensemble, pour nous montrer le potentiel du système choisi et sa disponibilité ». Le secteur de la finance reste ouvert aux nouvelles technologies : au contraire, les acteurs sont de plus en plus demandeurs de projets propres. « On a besoin de prototypes. À terme, ils permettront d’industrialiser le procédé ».
Car c’est cette industrialisation, qui rendra la technologie rentable à long terme. « Un nouveau mode de propulsion représente 20 % à 40 % de surcoût », explique Philippe Renaudin : « à nous de calculer, combien de temps il faut pour amortir ce surcoût ». Jusqu’alors, l’investissement – et le risque qu’il représente – est partagé entre tous les utilisateurs du navire : l’armateur, l’assurance, les investisseurs, mais aussi les chargeurs. TOWT, Grain de Sail, Neolines ont vu se concrétiser leurs projets, avec l’engagement au long terme de plusieurs clients.

Parallèlement à cette transition technique, c’est toute la carte géopolitique des océans qui est bouleversée. « Les tensions se sont révélées en 2014 », analyse Henry Allard, « lors de l’invasion de la Crimée ». Malgré le soutien de la Marine Nationale pour la sécurité de la navigation, le monde du courtage a senti un fort impact financier, tant sur l’assurance de la marchandise que sur celle du navire. « Aujourd’hui, transiter par le golfe d’Aden coûte une fortune ». C’est non seulement la guerre, mais aussi les tensions politiques : y compris au port et sur les zones de stockage. « Ce surcoût a un effet évident : il suffit de voir le nombre de navires se détournant par Le Cap. Le Canal de Suez a perdu 70 % de son trafic ».
L’explosion des zones à forte tension conduit à des décisions parfois dangereuses : « en mer Noire, la prime est si chère, que certains renoncent à assurer leur marchandise. La cargaison transite sans assurance dans le port et dans les eaux territoriales ». Henry Allard met également en garde contre les assurances des risques exceptionnels : « c’est un marché étroit et ultra-sensible », décrit-il, dénonçant même des « parieurs opportunistes ».
Face à cette instabilité, chacun voit en l’autorité publique un pilier central. « L’investissement maritime est très important pour notre monde », analyse Henry Allard. « C’est ce qui assure la continuité du commerce mondial ». D’un point de vue diplomatique, les sanctions à l’encontre des États sont décrits comme un obstacle efficace. « Jusqu’en 2013, on les décrivait plus comme des instruments de pénalisation. Mais aujourd’hui, on ne peut pas les contourner ». Christine Ezcutari décrit une close similaire à un défaut de paiement : « si un navire fait escale dans un pays sanctionné, l’investissement est gelé, le financement annulé ». Henry Allard confirme une close similaire dans le contrat d’assurance : « si l’assuré ne le respecte pas, il perd son assurance ». Dans un monde aux frontières sous tension, ces éléments font l’objet d’une vigilance permanente.

Concernant la décarbonation, l’État a, d’avis d’aucuns, un devoir de soutien. « Les idées en développement sont encore bien trop chères, pour concurrencer le pétrole », décrit Philippe Renaudin. Christine Ezcutari compare la situation présente, au retour en force du pavillon français dans les années 2020. « Si l’on a sauvé le pavillon français, c’est grâce à un engagement de l’État fort et cohérent, pour sa promotion au long terme ». Elle se félicite du résultat de cette politique, avec aujourd’hui plus de 400 navires sous pavillon français – contre à peine 200 dans les années 2000. « Il faut que l’État parle le même langage que les armateurs. Tous les armateurs, toute la filière maritime », explique-t-elle, rappelant l’importance des PME dans l’économie bleue française.
Côté assureurs, l’on demande d’abord une clarification des aides disponibles. « À l’échelle européenne, par exemple, la marine marchande est considérée comme une activité polluante : a priori, on ne peut pas bénéficier d’aide – même pour décarboner », explique Philippe Renaudin, expliquant déployer une équipe permanente pour la veille de ces normes. « La France a une large avance sur ses voisins », décrit Henry Allard, telle une chance à ne pas laisser passer.